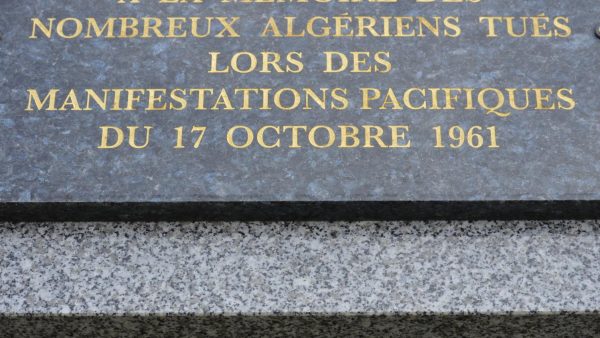Le 21 février dernier, Missak Manouchian et sa femme Mélinée Manouchian entraient au Panthéon. Ce jour-là, c’est toute la Résistance qui était enfin réunie, la résistance communiste, la résistance des immigrés, des étrangers, la Résistance populaire et ouvrière.
Au Panthéon, les Manouchian ont rejoint d’autres résistants, dont il faut se souvenir : Félix Eboué, Jean Moulin, René Cassin, Jean Monnet, André Malraux, les Justes de France, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Jean Zay et Joséphine Baker.
Au-delà des appartenances politiques des uns et des autres, c’est une famille de pensée, une famille de combats et de valeurs républicaines – la liberté et l’égalité de tous – qui s’est constituée dans l’adversité, et bien souvent au prix de la vie, au prix du sang versé pour une France des Lumières, une France des Droits de l’homme.
Quand Missak Manouchian intègre les francs-tireurs et partisans – Main d’œuvre immigrée, les FTP-MOI, il côtoie des juifs roumains, tchécoslovaques et hongrois, ainsi que des arméniens. La résistance est-elle déjà inscrite dans son parcours de vie ?
Missak Manouchian par exemple a neuf ans quand débute le génocide arménien. Son père va y perdre la vie. Déporté d’Ourfa avec sa famille, il est accueilli par une famille kurde ; sa mère succombe à la maladie ; il est pris en charge dans un orphelinat d’une organisation humanitaire américaine. Formé à la menuiserie, il triche sur son âge afin de trouver du travail en débarquant à Marseille, où il intègre la société des forges et chantiers de la Méditerranée. Manœuvre, monteur, tourneur, menuisier, laveurs de voiture, Missak rencontre dans le milieu ouvrier une camaraderie et une solidarité qui le formeront.
Sa condition de prolétaire ne lui suffit pas, « le travail de l’esprit » comme il le dit, lui est nécessaire. Il s’inscrit en auditeurs libres à la Sorbonne. C’est en 1934 qu’il adhère au Parti Communiste et œuvre pour l’émancipation de la classe ouvrière à travers ses rencontres et écrits journalistiques. La montée des périls, il la voit venir, et sa femme Mélinée se rappelle ses mots : « L’atmosphère est sombre, nous entrons dans une période d’affrontements. Notre génération va avoir à combattre le nazisme. Cela risque d’être terrible, mais nous en sortirons vainqueurs ».
En 39, après la signature du pacte germano-soviétique, il est interné comme suspect mais demande à être libéré pour combattre le même ennemi commun : Hitler et le IIIème Reich. La défaite de l’armée française et la collaboration le font basculer dès la première heure dans la résistance, au côté de ses camarades arméniens. La jonction avec les FTP MOI deviendra effective en 1943. Sabotages, attentats, contrairement à ce que la propagande allemande va instrumentaliser avec l’Affiche Rouge, Missak n’était pas un tueur sanguinaire, mais quelqu’un qui a une vision très humaine de la résistance.
Son devoir était de combattre le nazisme, coûte que coûte, à condition que les opérations soient ciblées, qu’elles ne frappent pas de civils, qu’elles ne versent pas dans la violence aveugle.
La filature de la police française, en coopération avec l’occupant allemand, mènera au démantèlement et à l’arrestation du groupe Manouchian. Après une parodie de procès et une justice expéditive, les 22 hommes seront fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944. Olga Bancic sera, elle, déportée et guillotinée en Allemagne, sans oublier Joseph Epstein, le chef des FTP MOI à Paris, arrêté le même jour mais fusillé plus tard, en avril 44.
Avant de conclure ce portrait rapide, de circonstance 80 ans après l’exécution, j’aimerais que chacun entende la dernière lettre de Missak adressée à sa femme, Mélinée, je la cite :
« Je m’étais engagé dans l’armée de la Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement».
La résistance des FTP MOI est une composante de la Résistance en France. En ce jour de commémoration, elle met en lumière le rôle des étrangers qui ont participé activement à la libération de notre pays. A l’heure où l’extrême droite joue sur les peurs, stigmatise les immigrés et cherche des boucs émissaires, il est important de rappeler que des bulgares, roumains, polonais, tchèques, hongrois, italiens, juifs pour beaucoup d’entre eux, ont permis à la France de retrouver dignité et liberté.
Nombreux combattants africains et maghrébins originaires des colonies, sujets de l’Empire français à l’époque, sont eux aussi entrés dans la France combattante, à l’image des 5 000 tirailleurs africains et malgaches, déserteurs ou évadés des camps de prisonniers. Indéniablement, ces hommes et ces femmes défendaient la France par amour, par reconnaissance. Ce n’était pas une opportunité mais une conviction profonde. Leur choix, c’était la France et uniquement la France, quand ils auraient pu résister dans d’autres pays.
Arsène Tchakarian, membre des FTP MOI, l’explique ainsi, j’ouvre les guillemets :
« Nous ne sommes pas des héros. Il ne faut pas croire que nous n’avions pas peur. Nous avons résisté parce que nous en avions la possibilité : pas de famille, pas de travail. Et parce que nous aimions la France. Elle nous avait adoptés ».
Avec sa poésie, Paul Eluard ne dit pas autre chose dans son poème Légion, dédié aux 23 : « C’est que des étrangers comme on les nomme encore – Croyaient à la justice ici-bas et concrète – Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables – Ces étrangers savaient quelle était leur patrie »
Sous l’Occupation, Il n’y a pas eu une résistance, mais plusieurs, pas plus qu’il n’y a eu un profil type de résistant en France métropolitaine. Tous savaient à quoi ils s’exposaient. Le risque, c’est le prix de leur vie et la peur des représailles envers leurs familles, leurs proches. Vivre tous les jours dans la crainte de la trahison, l’arrestation, la torture, les exécutions sommaires ou la déportation. C’est le choix de basculer dans la clandestinité, dans l’anonymat, de cacher son identité sous un nom d’emprunt, d’abandonner toute vie normale et de ne faire confiance qu’à quelques personnes, pas plus.
Beaucoup de résistants sont issus des classes populaires et ouvrières. Les syndicalistes, communistes, francs-maçons et socialistes sont les premières cibles du régime de Vichy et des milices de Pucheu.
A Paris, des premiers réseaux se constituent parmi les étudiants ou les intellectuels, comme l’organisation du Musée de l’Homme. Des pionniers de la Résistance se recrutent également dans des milieux de droite : notables, médecins, hauts fonctionnaires. Dans le Nord et la zone occupée, l’hostilité à l’occupation allemande est très marquée.
Des structures se mettent donc en place très rapidement pour exfiltrer en Angleterre des prisonniers de guerre ou des soldats alliés bloqués dans la poche de Dunkerque. Dans le Sud et la zone libre, l’organisation de la résistance y est plus tardive, même si de petites cellules se créent ici ou là.
Dès 1941, l’ensemble des forces communistes bascule dans la Résistance. Pour être plus efficaces, ces mouvements se rapprochent les uns des autres, les mouvements de la zone Sud vont ainsi fusionner au sein des Mouvements Unis de Résistance.
La loi de septembre 42 sur le service du travail obligatoire va faire basculer beaucoup de jeunes dans l’opposition au régime de Vichy, et alimenter la Résistance dans les maquis. La Résistance Intérieure franchira un cap une fois que Jean Moulin parviendra à l’unifier.
Au terme de ces étapes successives s’ébauche un gouvernement clandestin, bras armé de la libération du pays et laboratoire de notre modèle social français : le CNR, conseil national de résistance. Non seulement ils vont organiser la lutte armée, mais surtout penser et construire la République sociale de l’après-guerre.
Solidarité, sécurité sociale, répartition des richesses, grands services publics, c’est ce modèle-là, dans lequel nous vivons, que le CNR a élaboré et nous a légué.
Dans les manuels scolaires et ouvrages historiques, la Résistance est le plus souvent déclinée au masculin. S’il était nécessaire de réhabiliter le rôle des immigrés dans le combat de la liberté, il l’est également pour les femmes. Leur combat a été double : contre l’occupant et contre les lois scélérates et humiliantes sur la condition féminine adoptées par Vichy.
L’entrée récente au Panthéon de Germaine Tillion et de Geneviève de Gaulle-Anthonioz ne répare pas simplement une injustice, elle met des noms de femmes sur les absences d’un récit national tronqué : Lucie Aubrac, Lise London, Olga Bancic, Berthie Albrecht, Danielle Casanova, Elsa Triolet, Cécile Rol-Tanguy, femmes du Nord, femmes basques, corses, bretonnes, femmes immigrées…
On l’aura compris, ce qui a réuni cette communauté hétéroclite d’hommes et de femmes de la résistance, c’est de dire Non, de refuser l’inéluctable et la soumission.
Non à la France de Vichy qui foule aux pieds le siècle des Lumières et prend sa revanche sur le Front Populaire et l’héritage républicain. Non au Nazisme, qui prêche la haine de l’autre, la destruction de la démocratie pour soumettre l’individu et le citoyen à la pensée unique d’un régime totalitaire, dans la folie destructrice du nationalisme, du peuple supérieur, du mythe de la grande Allemagne purifiée.
S’opposer à une telle vague de rage et un tel déchaînement de pulsions primaires, quand les vents mauvais vous sont contraires, c’est un geste puissant, fort, héroïque.
Et c’est dans cette force exemplaire, à l’heure où notre monde bascule dans la tragédie des guerres, que nous devons puiser pour stopper net le bruit des armes et avancer ensemble vers la paix.
Je vous remercie.